|
|
L’astronomie ici et
ailleurs :
histoire, information et activités
locales
Dans nos archipels idylliques, la pollution lumineuse est en
revanche très faible. Le capitaine Cook ne s’y est pas trompé et les
observations astronomiques ultérieures ont toujours laissé des
témoignages sur l’ancienneté de ce privilège. Après avoir rappelé l’Histoire
de l’astronomie, nous évoquerons toutes les
informations sur les activités locales.
Histoire
Une histoire millénaire
A - L’AUBE DE L’ASTRONOMIE : LA PREPONDERANCE DU MYTHE (8000-300
avant J-C)
I - Dans l’Europe du néolithique (8000-1800 avant J-C) : Premiers
regards vers le ciel
Le monument de Stonehenge, en Angleterre, est le plus curieux
édifice de la période néolithique.
(photo :
illustration artistique du site de Stonehenge, Grande-Bretagne)

II - En Mésopotamie (3500-539 avant J-C) : Les cycles de la lune
Le dieu Mardouk tue Tiamat, l’Eau Salée ; il organise l’univers à
partir des débris de Tiamat. Les Sumériens inventent l’écriture
(cunéiforme). Les Babyloniens, qui leur succèdent, inventent
l’astrologie et élaborent leur calendrier en utilisant le cycle de
la lune.
III - En Egypte (3100-1000 avant J-C) : Le dieu-soleil
Rê, dieu du Soleil, est le fils de Nout, déesse du Ciel. Les
Egyptiens inventent le calendrier de 365 jours et les décans. Les
crues du Nil rythment leur vie.
IV - Les Hébreux : Dieu créateur de l’univers (1200-600 avant J-C)
Dieu crée la lumière puis l’univers entier. La Terre est le centre
de l’univers.
V - Les Chinois : L’équilibre cosmique (1500-500 avant J-C)
La Loi du Tao se manifeste sous deux formes opposées et
complémentaires : le Yin et le Yang. P’an-ku est l’homme cosmique.
VI - Les Hindous : L’absolu cosmique (1500-300 avant J-C)
Le Dieu des Hindous n’est pas créateur de l’univers ; il est
l’univers lui-même, nommé Brahman. L’une des formes qu’il prend est
Purusha, homme cosmique aux mille membres. C’est grâce à son
sacrifice que le monde prendra forme.
B - LES CONCEPTIONS DE L’UNIVERS CHEZ LES AMERICAINS PRECOLOMBIENS DU
MOYEN AGE : LA FASCINATION DU CIEL ET DU SOLEIL (IIIème
siècle-XVIème siècle après J-C)
I - Les Mayas de l’époque classique : Le goût de l’observation et du
calcul (250-900 après J-C)
L’univers est dominé par le dieu du Ciel Relevé et du maïs, Hun
Hunahpu.
II - Les Aztèques : Le Soleil sanglant (XIVème siècle-XVIème siècle)
Leur pratique religieuse est fondée sur des sacrifices humains
quotidiens. Les dieux principaux sont Huitzilopotchli, le dieu de la
Guerre, de l’Orage et du Soleil, et Quetzalcoatl, représenté sous la
forme d’un Serpent à plumes.
III - Les Incas : L’or du soleil (1420-1534)
Le dieu principal est le Soleil, Inti. Inca veut dire : fils du
Soleil.
C - VERS L’ASTRONOMIE SCIENTIFIQUE : LE GEOCENTRISME DES GRECS ET DE
LEURS HERITIERS (Xe siècle avant J-C-XVe siècle après J-C)
I - Les premiers grecs : Du mythe à la science (1000-500 avant J-C) :
Zeus, fils de Gaïa, la déesse-mère, dieu du Ciel et de la Foudre,
est le roi des dieux. Mais les philosophes présocratiques sont les
premiers à critiquer la mythologie et à comprendre que la Terre est
une sphère.
II - Les grands théoriciens grecs : Le goût de la philosophie et des
mathématiques (500 avant J-C-200 après J-C)
Les Grecs de cette époque (les philosophes Platon et Aristote) sont
les précurseurs de la science moderne ; Ptolémée sera le grand
astronome de l’époque : avec lui triomphe le géocentrisme. Il pense
que l’univers est constitué de sphères transparentes et
concentriques auxquelles sont accrochées les planètes et les
étoiles.
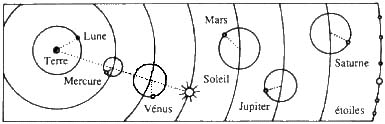 Synthèse
du système géocentrique proposé par Ptolémée, pour décrire les
mouvements apparents des étoiles, de la Lune, du Soleil et des cinq
planètes visibles à l'œil nu. Synthèse
du système géocentrique proposé par Ptolémée, pour décrire les
mouvements apparents des étoiles, de la Lune, du Soleil et des cinq
planètes visibles à l'œil nu.
III - Les Arabes : Les progrès de l’observation astronomique (VIIIe-XVe
s. après J-C)
Ce sont eux qui font le lien entre Ptolémée et le monde occidental
naissant. Ils réalisent des progrès dans l’observation et la
géométrie des sphères.
IV - Les chrétiens du moyen âge : Dieu et les anges, maîtres de
l’univers (XII-XVe s.)
Ils réalisent de meilleurs instruments et tables astronomiques + un
calendrier (grégorien). Ils ajoutent à celles de Ptolémée une sphère
immobile, l’Empyrée, où se trouve le paradis, résidence des anges et
des saints. Au sommet du ciel réside Dieu lui-même.
D - L’ASTRONOMIE MODERNE OCCIDENTALE (XVIème-XXème siècles) : DE L’HELIOCENTRISME
A LA PHYSIQUE DES ASTRES
I - Copernic, Kepler et Galilée : La révolution de l’héliocentrisme
(XVIe-XVIIe s.)
1 - L’intuition fondamentale de Copernic : il découvre que la Terre
tourne autour du Soleil.

2 - Les grands calculs et les trois lois de Kepler : c’est lui qui
va donner à l’héliocentrisme une dimension scientifique. 1ère loi :
l’orbite des planètes trace une ellipse, et non un cercle. 2nde
loi : la vitesse orbitale d’une planète varie selon sa position par
rapport au Soleil. 3ème loi : les planètes plus proches du soleil
avancent plus vite que les autres.
3 - La lunette de Galilée ou l’observation scientifique : Galilée
est le premier à observer le ciel avec une lunette. Ses observations
confirment l’héliocentrisme et lui font faire des découvertes
stupéfiantes. Mais ces découvertes ne plaisent pas du tout à l’Eglise :
Galilée devra avouer à genoux ses « erreurs » !
II - Newton et ses successeurs : La loi de la gravitation
universelle (XVIIe-XVIIIe et XIXe s.)
 Isaac Newton (1642-1727)
Isaac Newton (1642-1727)
Sa grande découverte est la loi de la gravitation universelle : deux
corps placés à une certaine distance s’attirent l’un l’autre, où
qu’ils se trouvent dans l’univers. La force de gravitation varie en
fonction de leur masse et de la distance qui les sépare. Newton est
aussi l’inventeur du premier télescope (1672). L’exploration du
système solaire va ainsi pouvoir devenir de plus en plus précise -
notamment avec l’astronome William Herschel (1738-1822).
III - La naissance des astrophysiciens : En quête de la nature des
astres (1840-début du XXe s.)
4 innovations révolutionnent l’étude de l’univers : 1) La
photographie ; 2) De nouveaux télescopes ; 3) La spectroscopie, qui
détecte les éléments chimiques d’une étoile ; 4) La photométrie (on
mesure les distances en les transformant en durées de trajet de la
lumière).
De plus, James Maxwell fonde la science de l’électromagnétisme. On
pourra alors déterminer la durée de vie des étoiles et explorer
l’espace bien au-delà de notre système solaire et de notre galaxie.
IV - Einstein et ses successeurs : La révolution de la relativité
générale (à partir de 1905)

1 - Einstein : Cet immense savant fait une découverte capitale, qui
bouleverse toute la théorie de Newton : la gravitation est une
simple conséquence du fait que l’espace-temps possède une courbure
due à la présence de masses. Elle n’est donc pas une mystérieuse
force agissant à distance. (L’univers ressemble à un tapis
élastique.)
Albert Einstein a été l'architecte de la théorie de la relativité
générale. Il publia ses travaux en 1917.
2 - Les successeurs d’Einstein : Mais Einstein refuse d’accepter
certaines conséquences capitales de sa découverte. Ses successeurs
s’en chargent : 1) Notre système solaire ne se trouve pas au centre
de notre galaxie, la Voie Lactée ; 2) Notre univers comporte
d’autres galaxies que la Voie Lactée ; 3) Notre univers est en
expansion : c’est la fameuse théorie du big bang (Hubble et
Lemaître) ; l’espace est comparable à un gâteau aux raisins (les
galaxies) qui, en gonflant, ferait s’éloigner les raisins les uns
des autres. Le temps devient également élastique (lié au mouvement
de celui qui le mesure). On découvre aussi les notions de « trous
noirs », de « matière sombre », ainsi que d’« anti-matière ».
Innovation technique à mentionner : la radioastronomie, qui permet
de détecter les ondes radio provenant du cosmos - notamment celles
du début de l’univers.
V - Autour de Niels Bohr : La révolution quantique (à partir de
1900)
Une dernière révolution se produit, dont les conséquences seront
tellement étranges qu’Einstein passera ses nuits à tenter de la
contredire, sans jamais y parvenir ! A la suite de Max Planck, Niels
Bohr remet en cause la théorie de la relativité générale en étudiant
les particules de la matière et de la lumière. Il établit que ces
prétendues particules ne se mettent à exister que quand on les
observe... C’est un peu comme si elles vivaient dans un monde
virtuel - le « flou quantique ». Tenter de décrire l’univers comme
quelque chose d’extérieur à nous n’a alors plus aucun sens.
(sources :
http://supervielle.univers.free.fr/astronomie)
L’astronomie à Tahiti
Le paradis des étoiles
Les conditions d'observation en Polynésie sont extrêmement bonnes,
c'est ce qui avait incité le Capitaine Cook à se rendre à Tahiti
pour effectuer un travail de relevé en 1769, avec la collaboration
d'autres stations en Sibérie, aux Indes, en Amérique et en Europe.
Un astronome californien de passage à Tahiti en 1922 nous le
rappelle.
« Depuis la fameuse visite faite par Cook pour observer le passage
de Vénus, Tahiti a plusieurs fois été choisi comme station par des
expéditions astronomiques (...). Quelles sont donc les raisons qui
tendaient alors et tendent encore aujourd'hui à faire choisir Tahiti
pour l'étude des astres ? Pour les expéditions qui ont visité
Tahiti, il s'agissait en général de l'observation de phénomènes
d'intérêt spécial, comme le passage de Vénus ou une éclipse totale
du Soleil. Les passages de Vénus devant le disque solaire se
produisent quatre fois dans une période de 243 ans et ils ont dans
le passé été de haute importance pour déterminer la distance de la
Terre au Soleil. C'est ce qui a décidé la visite de Cook à
Tahiti.(...) Pour le choix de la situation d'un Observatoire
permanent, il faut donner une large place aux conditions
atmosphériques, surtout à la proportion des nuits claires» (Trumpler
R, "Tahiti observatoire astronomique", B.S.E.O. n° 45, 16 juin, p.
16-22, 1922).
Clubs et associations à Tahiti
Le Club Océanien de Radio et d’Astronomie, créé en 1934 sous le nom
de « Radio Club Océanien », n’existe plus à Tahiti, mais nous
saluons au passage le livre paru en 1986, sous la plume de son
président, Maurice Graindorge : « Le ciel de Tahiti et des mers du
sud » qui, nous semble t-il, devrait être réédité chez Haere Po No
Tahiti.
La Société d’Astronomie de Tahiti est un club d’astronome assez
dynamique, qui propose des soirées d’observation astronomique. La
SAT a comme objectifs : de regrouper les astronomes amateurs de
Polynésie, de faciliter l'accès au grand public à des instruments de
grand diamétre et de promouvoir l'astronomie en général.
Pour cela, la SAT réalise notamment des soirées de d'initiation
ouvertes au public, des présentations, des publications dans la
presse locale…La SAT dispose d'un observatoire permanent situé sur
une colline proche de l'aéroport.
|
Pour vous y rendre, voici un plan
:
 |
Pour les joindre, voici leurs coordonnées :
Par courrier : BP 13358 Punaauia, Moana Nui, 98717, Polynésie
Française
Par téléphone :
(689) 87 75 09 77 (Claude Lamotte)
Par email : sat@mail.pf |
Le dernier passage de Vénus
Lors du dernier passage de Vénus devant le Soleil, l’association
C.I.E.L. en partenariat avec Proscience et l’association
astronomique S.A.T., nous avons commémoré, le 19 juin 2004, le
phénomène observé en 1769 à Tahiti au cours d’une journée
d’exposition sur « Le ciel du Monde Polynésien ».
Nous laissons la parole à Jean-Paul Longchamp (Société d'Astronomie
de Tahiti, SAT) afin qu’il nous explique le phénomène du passage de
Vénus devant le Soleil.
Chacune de ces années ? 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 ...est
marquée par le passage de Vénus devant le soleil, un "transit" pour
parler comme les astronomes. D'autres avant l'ont été pareillement
et d'autres après le seront aussi ...
Les historiens ont très largement relaté les efforts accomplis par
les expéditions parties aux quatre coins du mondes pour observer ce
phénomènes ...
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu motiver un tel déploiement de
moyens vers des contrées plus ou moins hospitalières et, en tous
cas, généralement lointaines ? ... à une époque où il ne suffisait
pas de prendre un billet d'avion pour se retrouver aux antipodes.
La réponse tient en un mot: la parallaxe ! Un grand mot bien
"ronflant" pour ne retenir que le "simple" ...
Vénus passe devant le soleil ... Mais pourquoi ? Est-elle la seule
planète à se permettre cette familiarité avec notre étoile ? Pour
lever un coin du voile, Vénus tourne autour du soleil en 224 jours
terrestres ... disons 8 mois. Vue de la tere, elle se déplace donc
d'un coté à l'autre du soleil tous les 4 mois ... une fois en
passant "par derrière" et une fois en passant "par devant".
Mais alors pourquoi est-ce un évènement si rare ? Pourquoi ne
peut-on observer ces transit chaque fois que la planète passe "par
devant" ?
A nouveau nous tenterons de répondre le plus simplement possible en
présentant d'abord le système solaire où nous verrons que tout n'est
pas aussi bien rangé qu'on le croit. Puis nous constaterons quelques
effets de ces désordres relatifs ... dont, entre autres, les rares
transits de Vénus.

(source : "Explication et illustration du phénomène du passage de
Vénus devant le soleil", par Jean-Paul Longchamp, Société
d'Astronomie de Tahiti, SAT)
La venue du capitaine Cook
Tahiti, abordée par hasard en 1767 par Wallis, transformée en
Nouvelle Cythère par Bougainville en 1768, devient, grâce à Cook et
aux savants qui l'accompagnent, l'un des 80 observatoires
astronomiques établis par les sociétés et académies savantes de
l'Europe du siècle des Lumières dans le Monde entier, afin de mieux
comprendre c'est-à-dire de mesurer la mécanique céleste.
Le transit de Vénus ne dure que quelques heures le 3 juin 1769, mais
le séjour des marins et des savants de l'Endeavour durera 3 mois. Ce
n'est plus un simple contact, mais la rencontre prolongée entre deux
mondes qui se découvrent avec de "doux souvenirs", des marchés, des
incidents et la violence née de malentendus.
Premier occidental à faire le tour de l'île de Tahiti, le capitaine
se transforme en ethnologue : Cook ne se contente pas d'être le
cartographe des îles, de leurs lagons et de leurs récifs, il est le
premier à dresser la carte des sentiments, des désirs, des émotions
et des interdits, des joies et des peines des hommes et des femmes
qui se mêlent et se côtoient; et les artistes qui l'accompagnent
nous restituent encore aujourd'hui les paysages, les villages, les
pirogues et les outils, la vie quotidienne et religieuse du Tahiti
des Temps anciens.
Ile d'expérience humaines mais aussi d'expérimentations
scientifiques, le Tahiti de 1769 annonce l'avenir des îles du
Pacifique...

(source :
"1769 : Cook ou
comment Vénus devient une pointe à Tahiti"
par Robert Koenig, Société des Etudes Océaniennes,
SEO) |







